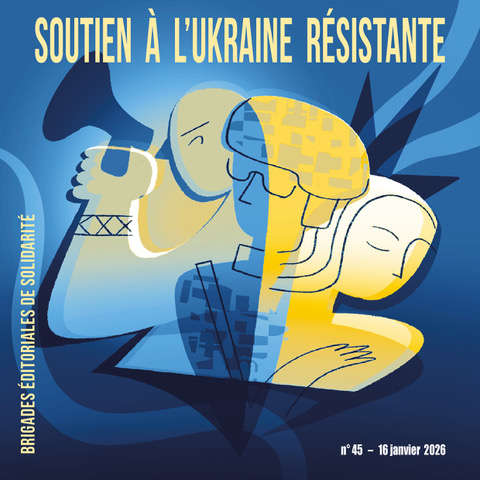Toujours être bienveillant : un slogan inattendu en temps de guerre, par Timothy Snyder
Il importe que l’Ukraine n’ait pas mené la guerre de la même manière que la Russie.

Une admirable leçon d’humanité du grand historien américain, qui vit désormais au Canada et continue de soutenir l’Ukraine et de travailler sur l’histoire ukrainienne.
Je vois le monde comme un parent. Avant la naissance de mes enfants, j’étais dans le jugement. Après quinze années passées auprès de mes enfants, je regarde les pères et les mères et je me dis : « Waouh, ils font du bon travail. »
Je viens d’avoir un moment comme celui-là en Ukraine, en parlant de la guerre des drones. J’étais à Kyïv, sur la place Saint-Michel, en train d’enregistrer une vidéo sur le travail que nous avons accompli ces trois dernières années pour collecter des fonds pour la défense contre les drones, un système qui protège les Ukrainiens en ce moment. Les passants savaient de quoi je parlais ; la pire attaque de drones sur Kyïv avait eu lieu quelques jours plus tôt.
À ma gauche, j’ai senti une présence. C’était une famille : une mère et un père, un garçon d’environ six ans. Quand le tournage s’est terminé, la mère est venue me dire un mot amical. En adressant un sourire d’adieu aux trois, j’ai vu le message inscrit sur le tee-shirt de son fils :
Always be kind [Soyez toujours bienveillant, NDLR].
La guerre et la parentalité sont proches. Les enfants sont tués et les parents survivent. Les parents sont tués et les enfants survivent.
Dans cette guerre, certains enfants ukrainiens survivent en Russie : enlevés et confiés à des familles russes pour être russifiés. Leur rééducation est un aspect sombre de cette guerre. Les enfants en Russie sont militarisés dès l’école primaire.
Il y a trois ans, je parlais avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, de la liberté ; il évoquait ce sujet en termes de parentalité, rappelant ses propres parents, faisant allusion à ses enfants. En essayant de trouver un moyen d’exprimer l’anormalité des parades militaires russes destinées aux plus jeunes, il a dit : « Les gamins veulent juste aller chez McDonald’s ! » C’était le père expérimenté qui parlait. Et emmener ses enfants au fast-food, c’est une parentalité acceptable. Même si ce n’est peut-être pas aussi bien que le tee-shirt :
Always be kind.
C’est difficile d’être un enfant. Et c’est difficile d’être un parent. Et le Covid a rendu tout encore plus difficile. Lorsque j’ai lu le tee-shirt et croisé le regard du garçon, j’ai pensé : toute sa vie, en supposant qu’il ait vécu ici à Kyïv, a été faite de Covid et d’alertes aériennes. L’invasion russe à grande échelle a commencé en février 2022, de sorte que pour les enfants ukrainiens, il n’y a pas eu d’intervalle entre les microbes et les bombes. Des millions de garçons et de filles ukrainiens suivent encore entièrement ou en partie leurs cours en ligne, parce que les Russes tirent des roquettes et des drones sur les écoles. Il faut du temps pour adapter des caves et construire de nouvelles écoles souterraines.
En Ukraine, et dans d’autres zones de guerre, et au milieu d’autres catastrophes et difficultés, des parents élèvent des enfants, ou les pleurent. Et ce qu’il faut admirer, ou du moins ce que j’admire, c’est la parentalité qui apprend aux enfants à être avec les autres, à faire des choses, et aussi à imaginer un monde différent de celui-ci, un monde meilleur. C’est un défi, non une échappatoire, d’enseigner :
Always be kind.
J’ai photographié ce message à mon retour à Kyïv après avoir visité divers points du front. Face à un ennemi qui combat sans restrictions, abandonnés par des alliés, vivant dans les extrêmes, les soldats ukrainiens ont beaucoup à dire sur la construction morale du monde, et ils le font avec une éloquence qui dépasse n’importe quel slogan. À Dnipro, je parlais avec un fantassin servant à Pokrovsk. On a pris sa photo. Il a dit : « Peut-être que je pourrai sourire quand tout cela sera fini. »
Nous ne serons pas toujours bienveillants. Il y a des moments où nous ne pouvons pas l’être. Il existe d’autres bonnes choses en dehors de la bienveillance, et nous devons faire des choix. Et souvent nous sommes faibles, ou déconcertés, ou épuisés.
Mais ce mot « always », sur la poitrine d’un garçon au cœur d’une ville pilonnée depuis trois ans, doit être là pour rappeler que les idéaux sont des idéaux, et qu’ils font partie de la réalité. « Sometimes be kind [Soyez parfois bienveillant, NDLR] » ne suffit pas tout à fait.
Il importe que l’Ukraine n’ait pas mené la guerre de la même manière que la Russie. L’approche russe a été criminelle dès le départ : l’invasion elle-même était illégale, et les enlèvements comme les bombardements de civils sont des crimes de guerre, tout comme la terreur systématique et les exécutions dans les territoires occupés. Nous en tirons un enseignement, tristement : trop souvent, nous regardons les ruines d’un bâtiment en Ukraine ou ailleurs et nous pensons que c’est simplement cela, la guerre. Mais ce n’est pas le cas. Une guerre peut être menée de différentes manières. Il importe que la Russie torture ses prisonniers de guerre et que l’Ukraine ne le fasse pas.
J’ai des amis qui ont survécu à la captivité russe. Je ne veux pas parler en leur nom. Je veux seulement dire que les mots qu’ils choisissent pour eux-mêmes, lorsqu’ils les trouvent, renvoient à ce qui les a précédés, à la manière dont ils ont été éduqués, à des idées de bien et de mal.
Always be kind.
La bienveillance paraît-elle un message naïf au cours d’une guerre d’extermination ? Pas pour moi. J’admire les parents chaleureux et les enfants bienveillants dans les meilleurs des temps, et je les admirerai aussi dans les pires.
Pour défendre, il faut avoir quelque chose à défendre. Ce sera toujours hors d’atteinte, mais ce qui compte, c’est de tendre la main, ou d’apprendre aux autres à le faire.

Si vous désirez recevoir une information régulière sur la situation en Ukraine et les initiatives de solidarité, abonnez-vous gratuitement à notre newsletter. Pour s'inscrire, CLIQUEZ ICI
Timothy Snyder
Timothy Snyder est un historien américain spécialiste de l’Europe orientale, ainsi que du nationalisme et de la tyrannie. Il est titulaire de la chaire Richard C. Levin d’histoire à l’université Yale et membre permanent de l’Institut des sciences humaines à Vienne. L’une de ses grandes œuvres, Terres de sang : L’Europe entre Hitler et Staline, est parue en français en 2012 (nouvelle édition augmentée date de 2022). Ses leçons sur l’histoire de l’Ukraine sont disponibles sur sa chaîne YouTube ainsi qu’en livre audio. Depuis l’invasion russe de 2022, Snyder est très engagé dans le soutien de l’Ukraine et de son armée. Son blog est une source précieuse d’analyse de la guerre russo-ukrainienne.
Sur l'ouvrage majeur de Timothy Snyder: "Terres de sangs"
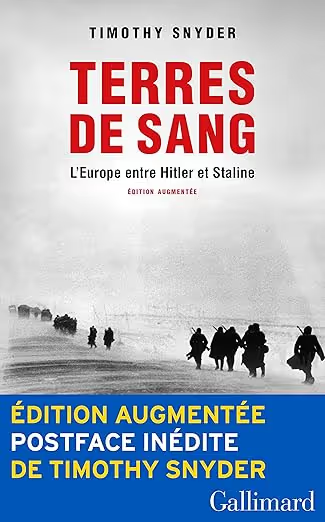
Au début du XXIᵉ siècle, alors que je concevais ce livre", nous dit Timothy Snyder dans cette postface inédite rédigée à la veille de la guerre en Ukraine, "il n'existait d'expressions familières que pour deux politiques de carnage : l'Holocauste et la Grande Terreur soviétique. Personne ou presque n'avait remarqué que dans les deux cas, les fosses de la mort étaient dispersées sur les mêmes territoires". C'est par ces mots que Timothy Snyder complète le récit de la catastrophe au cours de laquelle, entre 1933 et 1945, 14 millions de civils, ont été tués par l'Allemagne nazie et l'Union soviétique stalinienne. Tous l'ont été sur un même territoire, que l'auteur appelle les "terres de sang" et qui s'étend de la Pologne centrale à la Russie occidentale en passant par l'Ukraine, la Biélorussie et les pays Baltes. Plus de la moitié d'entre eux sont morts de faim. Deux des plus grands massacres de l'histoire ayant précédé l'Holocauste - les famines préméditées par Staline, principalement en Ukraine, au début des années 1930, qui ont fait plus de 4 millions de morts, et l'affamement par Hitler de quelque 3 millions et demi de prisonniers de guerre soviétiques, au début des années 1940 - ont été perpétrés ainsi. Les victimes des deux régimes ont laissé de nombreuses traces. Tombées après la guerre de l'autre côté du Rideau de fer, elles sont restées dans l'oubli pendant plus de soixante ans et ne sont revenues au jour qu'à la faveur de la chute du communisme. Timothy Snyder redonne humanité et dignité à ces millions de morts privés de sépultures et les rappelle au souvenir des vivants.
La critique de l'historien Nicolas Weil ("Le Monde", 27 avril 2012)
Vaste fresque savante, Terres de sang possède un contenu aussi grandiose et terrifiant que son titre. Il tire sa dimension tragique de l’unité d’action (le meurtre de masse), de temps (la période 1933-1945) et surtout de lieu (l’est de la Pologne, l’Ukraine, la Biélorussie). L’espace ainsi circonscrit par l’historien américain Timothy Snyder, professeur à Yale, a en effet été le théâtre des pires tueries collectives du continent. Là, le chevauchement de deux systèmes totalitaires a laissé, selon l’auteur, 14 millions de victimes, affamées sur ordre, tuées ou gazées, vivant dans leur chair la convergence entre communisme et nazisme.
Alors que les récits et témoignages sur la Shoah abondent, plus rares sont les descriptions aussi bouleversantes que les chapitres consacrés ici à la famine organisée par Staline en Ukraine au début des années 1930. La population y est poussée au cannibalisme. L’usage systématique de la faim comme arme la plus constante du crime de masse est d’ailleurs une perspective originale portée par l’ouvrage et illustrée d’anecdotes souvent insoutenables : faim dans les champs de l’Ukraine, faim derrière les barbelés des camps de prisonniers soviétiques, faim dans les ghettos… Traitant d’un seul tenant les massacres perpétrés par les deux régimes, Timothy Snyder réussit, comme peu l’ont fait avant lui, à dresser le tableau le plus exact et le plus haletant du « siècle de fer ».
Sans se laisser sidérer par les atrocités, il montre par exemple méthodiquement comment Hitler et Staline menèrent de concert l’anéantissement des élites polonaises, tombées en une véritable « guerre contre les Lumières européennes »,entre 1939 et 1941 ; comment les premiers massacres de juifs (la « Shoah par balle ») par les Allemands sont contemporains de ceux des Polonais par les Soviétiques (à Katyn notamment). Ils précèdent l’extermination des juifs, décidée en décembre 1941.
Pour la première fois, Timothy Snyder met en évidence la manière dont ces événements se répondent en s’enchaînant. Ainsi, dans la fantasmagorie nazie, la décision de tuer l’ensemble des juifs dans les « terres de sang » vise-t-elle à obtenir une victoire de substitution contre la « juiverie internationale », après l’échec de l’offensive allemande face à l’Armée rouge et alors que Staline a refusé, un an plus tôt, une proposition hitlérienne de déportation de 2 millions de juifs dans ses frontières. Côté soviétique, la déportation de peuples entiers ordonnée depuis Moscou achèvera de laminer ces provinces de l’horreur.
Du même l’auteur:
La folie de Trump en Alaska
« Antisémitisme » et Antisémitisme
Une troisième guerre mondiale ? Aidons ceux qui l’empêchent !
Six façons d’aider l’Ukraine
Les fausses victimes
Les « référendums » obscènes de la Russie. Un exercice médiatique d’humiliation, et un élément de crime de guerre
Manuel du génocide de la Russie